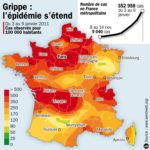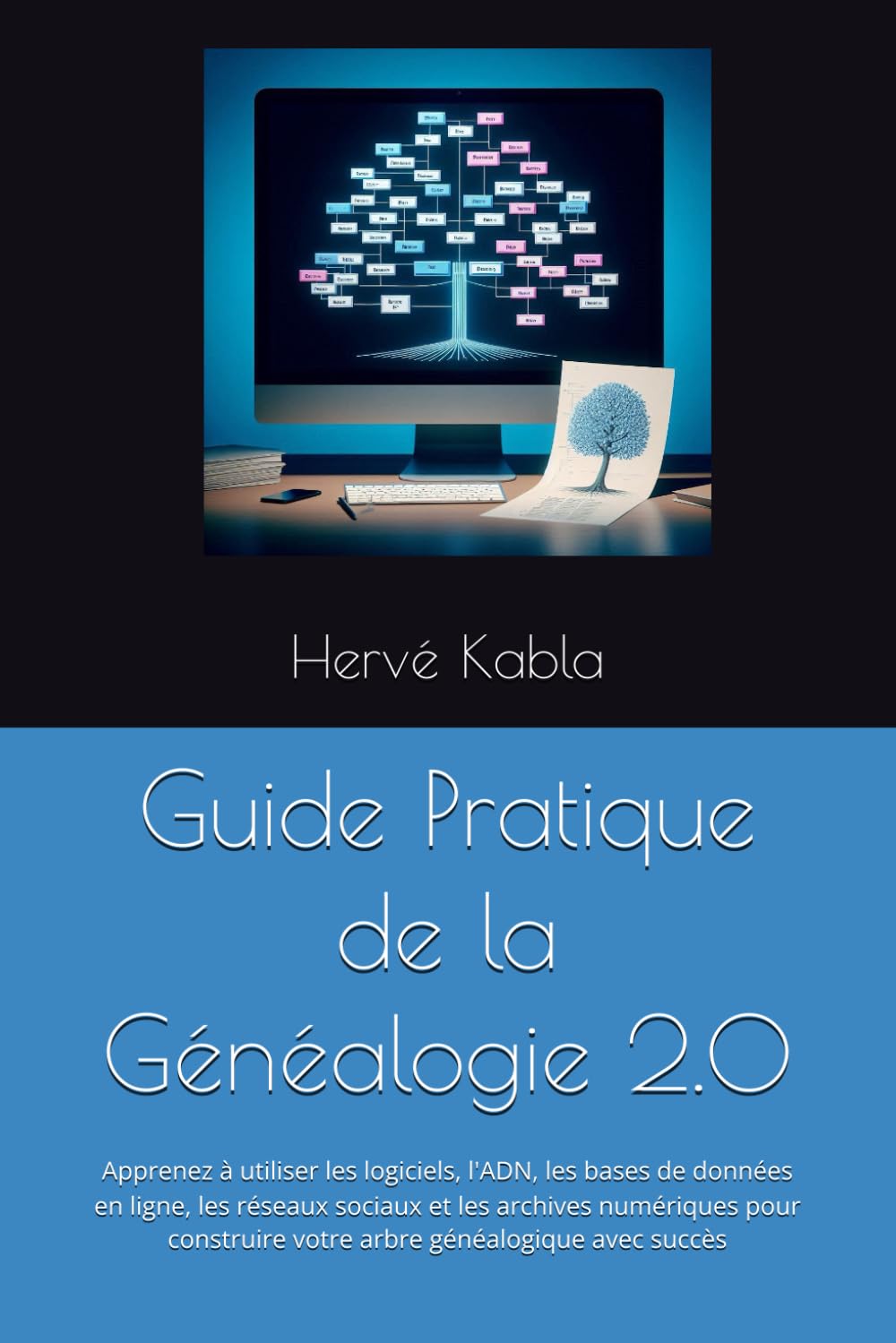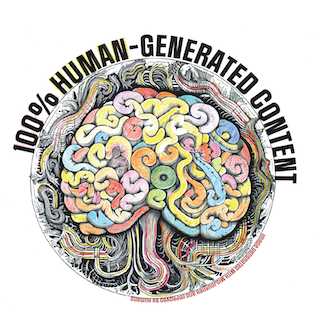Le Fléau
C’est en août dernier que j’ai acheté les deux épais volumes du Fléau, roman apocalyptique de Stephen King. En vacances à Juan les Pins, je m’étais rendu à la Librairie du Casino et y avais acquis deux romans de cet auteur, dont j’avais lu quelques années plus tôt l’excellent roman La ligne verte. J’ai englouti Dead Zone – un pavé lui aussi – en une journée, en octobre dernier. Et je me suis attaqué au Fléau il y a 3 semaines. Il m’a fallu plus de temps que je ne l’imaginais pour venir à bout des deux tomes de 800 pages chacun dans son édition de poche.
L’histoire rappelle, par certains aspects, l’époque que nous vivons, et il n’est pas étonnant que ses ventes aient connu un certain regain dès le début du confinement (à l’heure qu’il est, l’édition de poche est en rupture de stock chez Amazon). Car il s’agit, là aussi, d’une épidémie de grippe, et sacrément contagieuse.
Cependant, cette grippe là ne provient pas d’un virus passé d’un animal à l’homme, comme dans Contagions, mais d’un virus conçu dans un laboratoire américain, et qui se répand à une vitesse incroyable. En quelques jours, la population des États-Unis est décimée.
Seule subsiste une poignée de survivants. Résistants au virus pour une raison qu’on ignore, ils errent de ville en ville, jusqu’à ce qu’ils décident de se regrouper en communautés que tout oppose, autour de deux personnages plus ou moins inquiétants. On quitte alors le récit d’une épidémie de grippe à un combat entre le Bien et le Mal.

Le Fléau est le récit de ce combat. Souvent effrayant, parfois captivant, mais au final assez long. Surtout sur la fin. L’édition de poche est celle de 1990. Elle est plus longue que celle de 1978, que l’auteur a vraisemblablement adaptée à son époque. 1600 pages, ça fait beaucoup pour un tel récit.
Bref, pas à la hauteur de mes deux précédentes lectures de romans du maître.
Découvrez d'autres articles sur ce thème...
Hervé Kabla, ancien patron d’agence de comm’, consultant très digital et cofondateur de la série des livres expliqués à mon boss.
Crédits photo : Yann Gourvennec